|

Avis du libraire-éditeur
Nous ne donnons que des extraits du Livret de Paul-Louis, vigneron, dans lequel se trouvent beaucoup de choses intelligibles pour lui seul, d'autres trop hardies pour le temps, et qui pourraient lui faire de fâcheuses affaires. Nous avons supprimé ou adouci ces traits. Il faut respecter les puissances établies de Dieu sur la terre, et ne pas abuser de la liberté de la presse1.
- Monsieur de Talleyrand, dans son discours au roi pour l'empêcher de faire la guerre, a dit : Sire, je suis vieux. C'était dire : Vous êtes vieux ; car ils sont du même âge. Le roi, choqué de cela, lui a répondu : Non Monsieur de Talleyrand, non, vous n'êtes point vieux ; l'ambition ne vieillit pas.
Talleyrand parle haut, et se dit responsable de la Restauration.
Ces mots vieillesse et mort sont durs à la vieille cour. Louis XI les abhorrait, celui de mort surtout ; et afin de ne le point entendre, il voulut que quand on le verrait à l'extrémité, on lui dit seulement : parlez peu, pour l'avertir de sa situation. Mais ses gens oublièrent l'ordre ; et lorsqu'il en vint là, lui dirent crûment le mot, qu'il trouva bien amer. (Voir Philippe de Commines.)
- Marchangy2, lorsqu'il croyait être député, se trouvant chez M. Peyronnet3, examinait l'appartement qui lui parut assez logeable ; seulement il eût voulu le salon plus orné, l'antichambre plus vaste, afin d'y faire attendre et la cour et la ville, peu content d'ailleurs de l'escalier. Le Gascon, qui connut sa pensée, eut peur de cette ambition, et résolut de l'arrêter, comme il fit en laissant paraître les nullités de son élection, dont sans cela on n'eût dit mot.
- Quatre gardes du corps ont battu le parterre au Gymnase dramatique. On dit que cela est contraire à l'ordonnance de Louis XIII, qui leur défend de maltraiter ni frapper les sujets du roi sans raison. Mais il y avait une raison : c'est que le parterre ne veut point applaudir des couplets qui plaisent aux gardes du corps et leur promettent la victoire en Espagne s'ils y font la guerre, ce qui n'est nullement vraisemblable.
- Près des Invalides, six Suisses ont assailli quelques bouchers. Ceux-ci ont tué deux Suisses et blessé tous les autres, qui se sont sauvés en laissant sabres et shakos. Les bouchers devraient quelquefois aller au parterre, et les Suisses toujours se souvenir du 10 août.
- Lebrun4 trouve dans mon Hérodote un peu trop de vieux français, quelques phrases traînantes. Béranger pense de même sans blâmer cette façon de traduire. On est content de la préface.
- Le boulevard est plein de caricatures, toutes contre le peuple. On le représente grossier, débauché, crapuleux, semblable à la cour, mais en laid. Afin de le corrompre, on le peint corrompu. L'adultère est le sujet ordinaire de ces estampes. C'est un mari avec sa femme sur un lit et le galant dessous, ou bien le galant dessus et le mari dessous. Des paroles expliquent cela. Dans une autre, le mari, lorgnant par la serrure, voit les ébats de sa femme ; scène des Variétés.
Ce théâtre aura bientôt le privilège exclusif d'en représenter de pareilles. Il jouera seul les pièces qu'on appelle grivoises, c'est-à-dire sales, dégoûtantes, comme la Marchande de Goujons5. Les censeurs ont soin d'en ôter tout ce qui pourrait inspirer quelque sentiment généreux. La pièce est bonne pourvu qu'il n'y soit point question de liberté, d'amour du pays ;
elle est excellente, s'il y a des rendez-vous de charmantes femmes avec de charmants militaires, qui battent leurs valets, chassent leurs créanciers, escroquent leurs parents : c'est le bel air qu'on recommande. Corrompre le peuple est l'affaire, la grande affaire maintenant. A l'église et dans les écoles, on lui enseigne l'hypocrisie ; au théâtre, l'ancien régime et toutes ses ordures. On lui tient prêtes des maisons où il va pratiquer ces leçons.
En Angleterre, tout au contraire, les caricatures et les farces se font contre les grands, livrés à la risée du peuple, qui conserve ses mœurs et corrige la cour.
- Un homme, que j'ai vu, arrive d'Amérique. Il y est resté trois ans sans entendre parler de ce que nous appelons ici l'autorité. Nul ne lui a demandé son nom, sa qualité, ni ce qu'il venait faire, ni d'où, ni pourquoi, ni comment. Il a vécu trois ans sans être gouverné, s'ennuyant à périr. Il n'y a point là de salons. Se passer de salons, impossible au Français, peuple éminemment courtisan. La cour s'étend partout en France ; le premier des besoins, c'est de faire sa cour.
Tel brave à la tribune les grands, les potentats, et le soir devant… s'incline profondément, n'ose s'asseoir chez…, qui lui frappe sur l'épaule et l'appelle mon cher. Que de maux naissent, dit la Bruyère, de ne pouvoir être seul !
- A Boulogne-sur-Mer, M. Léon de Chanlaire avait établi une école d'enseignement mutuel, dans une salle bâtie par lui exprès avec beaucoup de dépenses. Là, trois cents enfants apprenaient l'arithmétique et le dessin. Les riches payaient pour les pauvres, et de ceux-ci cinquante se trouvaient habillés sur la rétribution des autres ; tout allait le mieux du monde. Ces enfants s'instruisaient et n'étaient point fouettés.
Les frères ignorantins, qui fouettent et n'instruisent pas, ont fait fermer l'école, et de plus ont demandé que la salle de M. de Chanlaire leur fût donnée par les jésuites, maîtres de tout. Chanlaire est accouru ici pour parler aux jésuites, et défendre son bien. (Nota, que toute affaire se décide à Paris ; les provinces sont traitées comme pays conquis.) Il va voir Frayssinous6 qui lui répond ces mots : Ce que j'ai décidé, nulle puissance au monde ne le saurait changer.
Parole mémorable, et digne seulement d'Alexandre ou de lui.
Tous ces célibataires fouettant les petits garçons et confessant les filles, me sont un peu suspects. Je voudrais que les confesseurs fussent au moins mariés ; mais les frères fouetteurs, il faudrait, sauf meilleur avis, les mettre aux galères, ce me semble. Ils cassent les bras aux enfants qui ne se laissent point fouetter. On a vu cela dans les journaux de la semaine passée. Quelle rage ! Flagellandi tam dira cupido !
Un Anglais m'a dit : Nos ministres ne valent pas mieux que les vôtres. Ils corrompent la nation pour le gouvernement, récompensent la bassesse, punissent toute espèce de générosité. Ils font de fausses conspirations, où ils mettent ceux qui leur déplaisent, puis de faux jurys pour juger ces conspirations. C'est tout comme chez vous. Mais il n'y a point de police. Voilà la différence.
Grande, très grande cette différence, à l'avantage de l'Anglais. La police est le plus puissant de tous les moyens inventés pour rendre un peuple vil et lâche. Quel courage peut avoir l'homme élevé dans la peur des gendarmes, n'osant ni parler haut, ni bouger, sans passeport ; à qui tout est espion, et qui craint que son ombre ne le prenne au collet ?
Pour faire fuir nos conscrits, les Espagnols n'ont qu'à s'habiller en gendarmes.
- Quand Marchangy voulut parler aux députés, il fut tout étonné de se voir contredit, et perdit la tête d'abord. Il lui échappa de dire, croyant être au palais : Qu'on le raye du tableau ; en prison les perturbateurs ; monsieur le président, nous vous requérons… Plaisante chose qu'un Marchangy à la tribune, sans robe et sans bonnet carré ; mais avec son bonnet…
Jeffries7, Laubardemont ! Il sera, dit-on, réélu, et songe à exclure les indignes.
- Les journaux de la cour insultent le duc d'Orléans. On le hait ; on le craint ; on veut le faire voyager. Le roi lui disait l'autre jour : Eh bien ! M. le duc d'Orléans, vous allez donc en Italie ? - Non pas sire, que je sache. - Mon Dieu si, vous y allez ; c'est moi qui vous le dis, et vous m'entendez bien. - Non sire, je n'entends point ; et je ne quitte la France que quand je ne puis faire autrement.
- Ce d'Effiat, député en ma place, est petit-fils de Rusé d'Effiat qui donna l'eau de chicorée à madame Henriette d'Angleterre. Leur fortune vient de là. Monsieur récompensa ce serviteur fidèle. Monsieur vivait avec le chevalier de Lorraine, que Madame n'aimait pas. Le ménage était troublé. D'Effiat arrangea tout avec l'eau de chicorée. Monsieur, depuis ce temps, eut toujours du contre-poison dans sa poche, et d'Effiat le lui fournissait.
Ce sont là de ces services que les grands n'oublient point, et qui élevent une famille noble. Mon remplaçant n'est pas un homme à donner aux princes ni poison ni contre-poison ; il ferait quelque quiproquo. C'est une espèce d'imbécile qui sert la messe, et communie le plus souvent qu'il peut. Il n'avait, dit-on, que cinquante voix dans le Collège électoral : ses scrutateurs ont fait le reste. J'en avais deux cent vingt connues.
- L'empereur Alexandre a dit à M. de Chateaubriand8 : « Pour l'intérêt de mon peuple et de ma religion, je devais faire la guerre au Turc ; mais j'ai cru voir qu'il s'agissait de révolution entre la Grèce et le Turc, je n'ai point fait la guerre. J'aime bien moins mon peuple et ma religion que je ne hais la révolution, qui est proprement ma bête noire. Je me réjouis que vous soyez venu ; je voulais vous conter cela. » Quelle confidence d'un empereur !
Et le romancier qui publie cette confidence ! Tout dans son discours est bizarre.
Il entend sortir les paroles de la bouche de l'empereur. On entend sortir un carrosse ou des chevaux de l'écurie ; mais qui diantre entendit jamais sortir des paroles ? Et que ne dit-il : Je les ai vues sortir, ces paroles, de la bouche de mon bon ami qui a huit cent mille hommes sur pied ? Cela serait plus positif, et l'on douterait moins de sa haute faveur à la cour de Russie.
Notez qu'il avait lu cette belle pièce aux dames ; et quand on lui parla d'en retrancher quelque chose, avant de la lire à la Chambre, il n'en voulut rien faire, se fondant sur l'approbation de madame Récamier. Or, dites maintenant qu'il n'y a rien de nouveau. Avait-on vu cela ? Nous citons les Anglais : est-ce que M. Canning9, voulant parler aux Chambres de la paix, de la guerre, consulte les ladys, les mistriss de la Cité ?
Les gens de lettres, en général, dans les emplois perdent leur talent, et n'apprennent point les affaires. Bolingbroke10 se repentit d'avoir appelé près de lui Addison et Steele.
- Socrate, avant Boissy d'Anglas11, refusa, au péril de sa vie, de mettre aux voix du peuple assemblé une proposition illégale. Ravez n'a point lu cela ; car il eût fait de même dans l'affaire de Manuel. Il est vrai que Socrate, présidant les tribus, n'avait ni traitement de la cour, ni gendarmerie à ses ordres. Manuel a été grand quatre jours ; c'est beaucoup. Que faudrait-il qu'il fît à présent ? Qu'il mourût, afin de ne point déchoir.
- D'Arlincourt12 est venu à la cour, et a dit : Voilà mon Solitaire et mes autres romans, qui n'en doivent guère au Christianisme de Chateaubriand. Mon galimatias vaut le sien ; faites-moi conseiller d'État au moins. On ne l'a pas écouté. De rage, il quitte le parti, et se fait libéral. C'est le maréchal d'Hocquincourt13, jésuite ou janséniste, selon l'humeur de sa maîtresse et l'accueil qu'il reçoit au Louvre.
- Ravez maudit son sort, se donne à tous les diables. Il a fait ce qu'il a pu, dans l'affaire de Manuel, pour contenter le parti jésuite . Il n'a point réussi. Ceux qu'il sert lui reprochent de s'y être mal pris, disent que c'est un sot, qu'il devait éviter l'esclandre, et qu'avec un peu de prévoyance, il eût empêché l'homme d'entrer, ou l'eût fait sortir sans vacarme. Fâcheuse condition que celle d'un valet ! Sosie l'a dit : Les maîtres ne sont jamais contents, Ravez veut trop bien faire.
Hyde de Neuville14 va mieux, et l'entend à merveille. Je vois, je vois là-bas les ministres de mon roi. Il a son roi, comme Pardessus15 : Mon roi m'a pardonné. Voilà le vrai dévouement. Le dévouement doit être toujours un peu idiot. Cela plaît bien plus à un maître que ces gens qui tranchent du capable.
- Serons-nous capucins, ne le serons-nous pas ? Voilà aujourd'hui la question. Nous disions hier : Serons-nous les maîtres du monde ?
- Ce matin, me promenant dans le Palais-Royal, M..ll…rd passe, et me dit : Prends garde, Paul-Louis, prends garde ; les cagots te feront assassiner. - Quelle garde veux-tu, lui dis-je, que je prenne ? ils ont fait tuer des rois ; ils ont manqué frère Paul, l'autre Paul, à Venise, Fra Paolo Sarpi16. Mais il l'échappa belle.
- Fabvier17, me disait un jour : Vos phraseurs gâtent tout : voulant être applaudis, ils mettent leur esprit à la place du bon sens, que le peuple entendrait. Le peuple n'entend point la pompeuse éloquence, les longs raisonnements. Il vous paraît, lui dis-je, aisé de faire un discours pour le peuple ; vous croyez le bon sens une chose commune et facile à bien exprimer.
- Le vicomte de Foucault18 nous parle de sa race. Ses ancêtres, dit-il, commandaient à la guerre. Il cite leurs batailles et leurs actions d'éclat. Mais la postérité d'Alphane et de Bayard, quand ce n'est qu'un gendarme aux ordres d'un préfet, ma foi, c'est peu de chose. Le vicomte de Foucault ne gagne point de batailles ; il empoigne les gens. Ces nobles, ne pouvant être valets de cour, se font archers ou geôliers. Tous les gardes du corps veulent être gendarmes.
- Les Mémoires de madame Campan19 méritent peu de confiance. Faits pour la cour de Bonaparte, qui avait besoin de leçons, ils ont été revus depuis par des personnes intéressées à les altérer. L'auteur voit tout dans l'étiquette, et attribue le renversement de la monarchie à l'oubli du cérémonial. Bien des gens sont de cet avis. Henri III fonda l'étiquette, et cependant fut assassiné. On négligea quelque chose apparemment ce jour-là. L'étiquette rend les rois esclaves de la cour.
Dans ces Mémoires, il est dit qu'une fille de garde-robe, sous madame Campan femme de chambre, avait dix-huit mille francs de traitement ; c'est trente-six mille aujourd'hui. Aussi tout le monde voulait être de la garde-robe. Que de gens encore passent la vie à espérer de tels emplois ! Montaigne quelque part se moque de ceux qui, de son temps, s'adonnaient à l'agriculture et à ce qu'il appelle ménage domestique. Allez, disait-il, chez les rois, si vous voulez vous enrichir. Et Démosthène :
Les rois, dit-il, font l'homme riche en un mot, et d'un seul mot ; chez vous, Athéniens, cela ne se peut, il faut travailler ou hériter. Qu'on mette à Genève un roi avec un gros budget, chacun quittera l'horlogerie pour la garde-robe ; et comme les valets du prince ont des valets, qui eux-mêmes en ont d'autres, un peuple se fait laquais. De là l'oisiveté, la bassesse, tous les vices, et une charmante société.
Madame Campan fait de la reine un modèle de toute vertu ; mais elle en parlait autrement ; et l'on voit dans O'Meara20 ce qu'elle disait à Bonaparte ; comme, par exemple, que la reine avait un homme dans son lit la nuit du 5 au 6 octobre ; et que cet homme, en se sauvant, perdit ses chausses, qui furent trouvées par elle, madame Campan. Cette histoire est un peu suspecte. M. de la Fayette ne la croit point. Bonaparte a menti, ou madame Campan.
Elle écrit mal, et ne vaut pas madame de Motteville, qui était aussi femme de chambre. Madame du Hausset21, autre femme de chambre, va paraître. On imprime ses Mémoires très curieux. Ce sont-là les vrais historiens de la monarchie légitime.
Quelqu'un montre une lettre de M. Arguelles22, où sont ces propres mots : Votre roi nous menace ; il veut nous envoyer un prince et cent mille hommes, pour régler nos affaires selon le droit divin. Voici notre réponse : Qu'il exécute la Charte, ou nous lui enverrons Mina23 et dix mille hommes avec le drapeau tricolore ; qu'il chasse ses émigrés et ses vils courtisans, parce que nous craignons la contagion morale.
- Horace24 va faire un tableau de la scène de Manuel. Mais quel moment choisira-t-il ? Celui où Foucault dit : Empoignez le député ; - ou bien quand le sergent refuse ? j'aimerais mieux ceci. Car, outre que le mot empoignez ne se peut peindre (grand dommage sans doute), il y aurait là deux ignobles personnages, Foucault et le président, qui, à dire vrai, n'y était pas, mais auquel on penserait toujours. Dans cette composition, l'odieux dominerait, et cela ne saurait plaire, quoi qu'en dise Boileau.
L'instant du refus, au contraire, offre deux caractères nobles, Manuel et le sergent, qui tous deux intéressent, non pas au même degré, mais de la même manière, et par le plus bel acte dont l'homme soit capable, résister au pouvoir. De pareils traits sont rares ; il les faut recueillir et les représenter, les recommander au peuple. D'autre part, on peut dire aussi que Manuel, Foucault, ses gendarmes, donneraient beaucoup à penser : et le président derrière la toile ;
car il est des objets que l'art judicieux…25 La contenance de Manuel et la bassesse des autres formeraient un contraste ; ceux-ci servant des maîtres, et calculant d'avance le profit, la récompense toujours proportionnée à l'infamie de l'action ; celui-là se proposant l'approbation publique et la gloire à venir.
- Les fournisseurs de l'armée sont tous bons gentilshommes et des premières familles. Il faut faire preuves pour entrer dans la viande ou dans la partie des souliers. Les femmes y ont de gros intérêts ; les maîtresses, les amants partagent ; comtesses, duchesses, barons, marquis, on leur fait à tous bon marché des subsistances du soldat. La noblesse autrefois se ruinait à la guerre, maintenant s'enrichit et spécule très bien sur la fidélité.
- Les bateaux venus de Strasbourg à Bayonne par le roulage coûteront de port cent mille francs, et seront trois mois en chemin. Construits en un mois à Bayonne, ils eussent coûté quarante mille francs. Les munitions qu'on expédie de Brest à Bayonne, par terre, iraient par mer sans aucun frais. Mais il y a une compagnie des transports par terre, dans laquelle des gens de la cour sont intéressés, et l'on préfère ce moyen. Il faut relever d'anciennes familles, qui relèveront la monarchie si elle culbute en Espagne.
- Les parvenus imitent les gens de bonne maison. Victor26, sa femme, son fils, prennent argent de toutes mains. On parle de pots-de-vin de cinquante mille écus. Tout s'adjuge à huis clos et sans publication. Ainsi se prépare une campagne à la manière de l'ancien régime. Cependant Marcellus danse avec miss Canning.
- La guerre va se faire enfin, malgré tout le monde. Madame ne la veut pas. Madame du Cayla y paraît fort contraire. Mademoiselle27, ayant consulté sa poupée, se déclare pour la paix, ainsi que la nourrice et toutes les remueuses de monseigneur le duc de Bordeaux. Personne ne veut la guerre. Mais voici le temps de Pâques, et tous les confesseurs refusent l'absolution si on ne fait la guerre : elle se fera donc.
- Le duc de Guiche28, l'autre jour, disait dans un salon, montrant le confesseur de Monsieur et d'autres prêtres : Ces cagots nous perdront.
- On me propose cent contre un que nos jésuites ne feront pas la conquête de l'Espagne, et je suis tenté de tenir. Sous Bonaparte, je proposai cent contre un qu'il ferait la conquête de l'Espagne : personne ne tint ; j'aurais perdu : peut-être cette fois gagnerais-je.
- Mille contes plaisants du héros pacificateur, pointes, calembours de toutes parts. Il crève les chevaux sur la route de Bayonne, fait, dit-on, quatre lieues à l'heure, va plus vite que Bonaparte, mais n'arrive pas sitôt, parce que ses dévotions l'arrêtent en chemin. Il visite les églises et baise les reliques. Le peuple, qui voit cela, en aime d'autant moins l'Église et les reliques.
- Il n'y a pas un paysan dans nos campagnes qui ne dise que Bonaparte vit, et qu'il reviendra29. Tous ne le croient pas, mais le disent. C'est entre eux une espèce d'argot, de mot convenu pour narguer le gouvernement. Le peuple hait les Bourbons, parce qu'ils l'ont trompé, qu'ils mangent un milliard et servent l'étranger, parce qu'ils sont toujours émigrés, parce qu'ils ne veulent pas être aimés.
- Barnave disait à la reine : « Il faut vous faire aimer du peuple. - Hélas ! je le voudrais, dit-elle ; mais comment ? - Madame, il vous est plus aisé qu'il ne l'était à moi. - Comment faire ? - Madame, lui répondit Barnave, tout est dans un mot , bonne foi. »
On va marcher ; on avancera en Espagne ; on renouvellera les bulletins de la grande armée avec les exploits de la garde ; au lieu de Murat, ce sera La Rochejaquelein30. Sans rencontrer personne, on gagnera des batailles, on forcera des villes, enfin on entrera triomphant dans Madrid, et là commence la guerre. Jamais ils ne feront la conquête d'Espagne. M. Ls31.
Je le crois ; mais ce n'est pas l'Espagne, c'est la France qu'ils veulent conquérir. A chaque bulletin de Martainville, à chaque victoire de messieurs les gardes du corps, on refera ici quelque pièce de l'ancien régime : et qu'importe aux jésuites que les armées périssent, pourvu qu'ils confessent le roi ?
- A la chambre des pairs, hier quelqu'un disait : Figurez-vous que nos gens en Espagne seront des saints. Ils ne feront point de sottises ; on payera tout, et le soldat ne mangera pas une poule qui ne soit achetée au marché. Ordre, discipline admirable ; on mènera jusqu'à des filles, afin d'épargner les infantes. La conquête de la péninsule va se faire sans fâcher personne, et notre armée sera comblée de bénédictions. Là-dessus M. Catelan32 a pris la parole, et a dit :
Je ne sais pas comment vous ferez lorsque vous serez en Espagne ; mais en France votre conduite est assez mauvaise. Vous payerez là, dites-vous, et ici vous prenez. Voici une réquisition de quatre mille bœufs pour conduire de Toulouse à Pau votre artillerie, qui a ses chevaux ; mais ils sont employés ailleurs. Ils mènent les équipages des ducs et des marquis et des gardes du corps. Le canon reste là. Vous y attelez nos bœufs au moment des labours.
Vous serez sages en Espagne, à la bonne heure, je veux croire, et vous agirez avec ordre ; mais je ne vois que confusion dans vos préparatifs.
- Guilleminot33 a fait un rapport, dont la substance est que l'armée a besoin de se recruter d'une ou de deux conscriptions, pour être en état, non de marcher, car il n'y a nulle apparence, mais de garder seulement la frontière ; que l'état-major est bon, et fera ce qu'on voudra ; mais que les officiers de fortune, et surtout les sous-officiers, semblent peu disposés à entrer en campagne, pensent que c'est contre eux que la guerre se fait.
Guilleminot est rappelé pour avoir dit ces choses-là, et son aide de camp arrêté comme correspondant de Fabvier. Victor part pour l'armée.
- A l'armée une cour (voir là-dessus Feuquières34, Mémoires), c'est ce qui a perdu Bonaparte, tout Bonaparte qu'il était. La cour de son frère Joseph sauva Wellington plus d'une fois. Partant, où il y a une cour, on ne songe qu'à faire sa cour. Le duc d'Angoulême a carte blanche pour les récompenses, et l'on sait déjà ceux qui se distingueront. Hohenlohe35 sera maréchal. C'est un Allemand qui a logé les princes dans l'émigration.
Il commandera nos généraux, et pas un d'eux ne dira mot. La noblesse de tout temps obéit volontiers même à des bâtards étrangers, comme était le maréchal de Saxe. Les soldats, quant à eux, font peu de différence d'un Allemand à un émigré. Ils l'aimeront autant que Coigny ou Vioménil36. Personne ne se plaindra. Jamais, en Angleterre, on ne souffrirait cela. Nous aurons tout l'ancien régime ; on ne nous fera pas grâce d'un abus.
PROCLAMATION
Soldats, vous allez rétablir en Espagne l'ancien régime et défaire la révolution. Les Espagnols ont fait chez eux la révolution ; ils ont détruit l'ancien régime, et à cause de cela on vous envoie contre eux ; et quand vous aurez rétabli l'ancien régime en ce pays-là, on vous ramènera ici pour en faire autant. Or, l'ancien régime, savez-vous ce que c'est, mes amis ? C'est, pour le peuple, des impôts ;
pour les soldats, c'est du pain noir et des coups de bâton ; des coups de bâton et du pain noir, voilà l'ancien régime pour vous. Voilà ce que vous allez rétablir, là d'abord, et ensuite chez vous.
Les soldats espagnols ont fait en Espagne la révolution. Ils étaient las de l'ancien régime, et ne voulaient plus ni pain noir, ni coup de bâton ; ils voulaient autre chose, de l'avancement, des grades ; ils en ont maintenant, et deviennent officiers à leur tour, selon la loi. Sous l'ancien régime, les soldats ne peuvent jamais être officiers ; sous la révolution, au contraire, les soldats deviennent officiers. Vous entendez ; c'est là ce que les Espagnols ont établi chez eux, et qu'on veut empêcher.
On vous envoie exprès, de peur que la même chose ne s'établisse ici, et que vous ne soyez quelque jour officiers. Partez donc, battez-vous contre les Espagnols ; allez, faites vous estropier, afin de n'être pas officiers et d'avoir des coups de bâton.
Ce sont les étrangers qui vous y font aller ; car le roi ne voudrait pas. Mais ses alliés le forcent à vous envoyer là. Ses alliés, le roi de Prusse, l'empereur de Russie et l'empereur d'Autriche suivent l'ancien régime. Ils donnent aux soldats beaucoup de coups de bâton avec peu de pain noir, et s'en trouvent très bien, eux, souverains. Une chose pourtant les inquiète. Le soldat français, disent-ils, depuis trente ans ne reçoit point de coups de bâton, et voilà l'Espagnol qui les refuse aussi :
pour peu que cela gagne, adieu la schlague chez nous, personne n'en voudra. Il y faut remédier plus tôt que plus tard. Ils ont donc résolu de rétablir partout le régime du bâton, mais pour les soldats seulement ; c'est vous qu'ils chargent de cela. Soldats, volez à la victoire ; et quand la bataille sera gagnée, vous savez ce qui vous attend : les nobles auront de l'avancement, vous aurez des coups de bâton. Entrez en Espagne, marchez tambour battant, mèche allumée, au nom des puissances étrangères :
vive la schlague ! vive le bâton ! point d'avancement pour les soldats, point de grades que pour les nobles.
Au retour de l'expédition, vous recevrez tout l'arriéré des coups de bâton qui vous sont dus depuis 1789. Ensuite, on aura soin de vous tenir au courant.
- La police va découvrir une grande conspiration qui aura, dit-on, de grandes ramifications dans les provinces et dans l'armée. On nomme déjà des gens qui en seront certainement. Mais le travail n'est pas fait.
[1] Nous n’avons pas besoin de dire que cet avis est de Courier lui-même ; il se trouvait en tête de la première édition du Livret. Nous l’avons conservé. (Note de l’éditeur).

|
[2] Louis Antoine François de Marchangy (1782-1826), d’abord avocat à la cour royale de Paris fut un fervent royaliste. Il fut chargé de requérir dans les procès politiques et s’en acquitta avec beaucoup de zèle. Ses principaux réquisitoires furent dirigés contre Bergasse puis Béranger en 1821, et contre les quatre sergents de La Rochelle. En 1823, le grand collège du département du Nord l’élut député mais il fut invalidé parce qu’il ne payait pas d’impôt. Réélu l’année suivante par le même collège, il siégea. Réélu en 1824, son élection fut de nouveau invalidée.

|
[3] Charles Ignace de Peyronnet (1778-1854) que Courier appelle le Gascon naquit à Bordeaux. Député de la Gironde en 1820, il devint ministre de la Justice en décembre 1821 et attacha son nom à toutes les mesures absolutistes que combattit Courier comme la loi sur la presse, la loi du sacrilège… Réélu le 6 mars 1824 député du Cher et député de la Gironde, il opta pour la Gironde. En janvier 1828, Charles X le nomma pair de France. C’est lui qui, en 1830, signa en tant que ministre de l’Intérieur les ordonnances de juillet qui précipitèrent la chute du régime.
 |
[4] Pierre Antoine Lebrun (1785-1873) fut désigné comme troisième Consul par Bonaparte. Poète précoce, il fut député, sénateur, nommé duc de Plaisance et pair de France ; il s'occupa d'économie politique et dirigea le Journal des Savants ; il fut aussi directeur de l'Imprimerie royale de 1831 à 1848. Lauréat de l'Académie en 1817, il donna plusieurs œuvres dramatiques, dont la meilleure, Marie Stuart, fut considérée comme la première victoire du romantisme au théâtre. Rallié aux Bourbons, il publia une traduction de l’Odyssée après avoir déjà traduit l’Iliade. Comme Béranger, il était réservé sur les traductions de Courier en style ancien à la façon d’Amyot, ce qui ne l’aurait pas empêché de rendre visite au pamphlétaire à Sainte Pélagie. Il fut élu à l'Académie française le 21 février 1828. Ultérieurement, il vota pour Victor Hugo et pressa vainement Béranger de faire acte de candidature. Sous le second Empire, il appartint au groupe impérialiste dirigé par Sainte-Beuve.
 |
[5] La Marchande de Goujons ou les trois bossus, vaudeville grivois, de Francis et Dartois (mars 1821).
 |
[6] Né en Aveyron en 1765, Frayssinous fut quelque temps vicaire d'une paroisse ; il disparut pendant la tourmente révolutionnaire pour ne reparaître qu'en 1801. De retour en France, il se signala en 1807 par des conférences religieuses qui déplurent à Bonaparte. Mais l’abbé mit de l’eau dans son vin et s'attira la bienveillance de M. de Fontanes, qui le nomma inspecteur général de l'académie de Paris. Remonté en chaire en 1814, il lança les plus violents anathèmes contre le pouvoir déchu, l'incrédulité des temps et les odieux principes de la Révolution. En 1817, Le Panégyrique de Saint Louis, prononcé à l'Académie française prépara son entrée dans cette assemblée et lui valut le titre de prédicateur du roi. L'abbé Frayssinous se fit dès lors appeler M. de Frayssinous. Comme aucun évêché n'était vacant, il fut sacré évêque d'Hermopolis, in partibus infidelium, mais ne songea guère à visiter son diocèse ; il resta à Paris, où l'attendait encore une haute dignité en 1822, celle de grand maître de l'Université, spécialement rétablie pour lui. Il fut élu à l’Académie française le 27 juin 1822. Ce fut lui qui prononça, à Saint-Denis, l'oraison funèbre de Louis XVIII. Il attacha une importance extrême à la pompe extérieure, et en étalait autant que pouvait en comporter son caractère épiscopal : habits somptueux, nombreux valets, brillants équipages étaient fort prisés du petit abbé natif du Rouergue, devenu l'un des grands dignitaires de l'Église. Il apporta dans l'exercice de ses fonctions de grand maître de l'Université une solennité luxueuse ; il avait un train de prince pour présider à la Sorbonne. Après la révolution de Juillet, il rejoignit Charles X et sa famille à Prague et servit de précepteur à « l’enfant du miracle ». Il mourut dans sa région natale en décembre 1841.
 |
[7] Sir George Jefferies ou Jeffrys (1645-1689). Magistrat anglais qui devint chancelier sous Charles II et Jacques II. Il se signala par sa cruauté et son arbitraire en agent zélé de la réaction royaliste. Lors de la Grande Révolution de 1688 conduite par la noblesse anglaise, il fut mis en prison à la Tour de Londres et y mourut de maladie au bout de quelques mois.
 |
[8] Cette réflexion de l’empereur dut avoir lieu lors du Congrès de Vérone qui se déroula en novembre et décembre 1822.
 |
[9] George Canning (1770-1827) grand homme d’état anglais du parti tory. En mai 1804, Pitt constitue son ministère, et nomme Canning Trésorier à la Marine. La mort de Pitt en janvier 1806 fait perdre son poste à Canning. En 1807, le cabinet du duc de Portland lui donne celui de ministre des affaires étrangères. Il fut partisan de la guerre à outrance contre Napoléon. Dans le même gouvernement, Lord Castlereagh est ministre de la Guerre. Les deux hommes, qui se haïssent se battent en duel. Aussi sont-ils exclus du ministère en 1809. Il reste éloigné du gouvernement. Lorsque le 12 août 1822, Lord Castlereagh se suicide il est rappelé au ministère des affaires étrangères. Il inaugura une politique libérale et ouverte qui contraste avec l’étroitesse de vues des ministres de Louis XVIII.
 |
[10] Lord Henry Bolingbroke (1678-1751), homme d’État anglais du parti tory ; un des principaux artisans de la paix d’Utrecht. – Joseph Addison (1672-1719), poète et auteur dramatique de grand talent et homme politique de petit. – Richard Steele (1671-1729), auteur dramatique et essayiste. Ami d’enfance d’Addison, il finit par se brouiller avec lui.
 |
[11] Courier fait allusion au courage dont fit preuve Boissy d’Anglas ((1756-1826), alors président de la Convention, dans la journée du 12 germinal an III (1er avril 1795). Ce jour-là, au péril de sa vie, il sauva l’assemblée envahie par la foule des faubourgs qui réclamait des vivres et des mesures sévères contre les royalistes.
 |
[12] Le fameux vicomte Victor d’Arlincourt (1789-1856) était le fils d'un fermier général victime de la Révolution. Auditeur au Conseil d'Etat sous l'Empire, il se rallia en 1814 aux Bourbons. Louis XVIII le nomma maître des requêtes. Jouissant d'une belle fortune, il quitta les affaires après les Cent-Jours pour s’adonner aux lettres. Il rédigea des romans extravagants dont le plus connu, écrit en 1821, reste le Solitaire, dont le sujet était emprunté au Moyen âge et qui, en dépit d’un style ampoulé, eut une vogue prodigieuse parce qu'on y trouvait de l'imagination et de l'intérêt. Il mourut complètement oublié.
 |
[13] Charles de Monchy, marquis d'Hocquincourt (1599-1658) fit ses premières armes en Italie et, en 1641, combattit contre les Espagnols. Général des armées d’Allemagne en 1646, il prit une part importante aux ultimes batailles de la guerre de Trente ans. Fidèle au parti de la Fronde, il gagna sur Turenne la bataille de Rethel en 1650. Maréchal de France l’année suivante, il fut battu par Condé en 1652, à Bléneau. Généralissime et vice-roi du Roussillon et de la Catalogne, il échoua au siège de Girone. Devenu gouverneur de Ham et de Péronne, il se déshonora par amour pour la duchesse de Montbazon et par ressentiment contre Mazarin. Passé au service de l’Espagne qui le chargea de défendre Dunkerque assiégé par les Français, il fut tué en tournée d’inspection. Saint Evremond a relaté une conversation avec le père Canaye dans laquelle le maréchal explique qu’il a quitté les jansénistes parce que l’abbé de Rancé, soupçonné de jansénisme lui-même, tournait trop autour de la duchesse. Courier avait lu de très près cette conversation et devait connaître les frasques de l’abbé de Rancé, châtelain de Véretz après la mort de son frère aîné en 1637.
 |
[14] Jean-Guillaume, baron Hyde de Neuville (1776-1847). Cet homme politique français resta fidèle aux Bourbons durant la Révolution et l'Empire. Proche du comte d'Artois, il accomplit plusieurs missions en Angleterre, rencontra Pitt et s'installa en Angleterre. Il retourna en France, rencontra Bonaparte et lui proposa de rétablir Louis XVIII sur le trône. Fouché l’accusa d'avoir participé à l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Il parvint à se disculper et quitta la France pour s'établir aux États-Unis. Il est élu député de la Nièvre à la Chambre en 1815, réélu jusqu’en 1827 et siège dans le groupe des monarchistes constitutionnels. A la Chambre, il se prononce contre la guerre d'Espagne. Ministre de la Marine en 1828 dans le cabinet Martignac, il se retire de la vie politique sous la Monarchie de juillet. Aux yeux de Courier, ce fervent royaliste est le type du courtisan dévoué, du serviteur humble et bêlant de la monarchie.
 |
[15] Jean-Marie Pardessus (1772-1854) fut élevé par les oratoriens. Fils d’un avocat, il devint à son tour magistrat. En 1804, il est maire de Blois, sa ville natale et en est élu député en 1807. En 1815, il est de nouveau député du Loir-et-Cher. En 1820, il se présente aux législatives à Blois et Marseille. Il est élu dans les deux villes et choisit de siéger comme député de la cité phocéenne. En 1829, il est élu à l’Académie des Belles Lettres et Inscriptions. Il refuse de prêter serment à Louis-Philippe et délaisse alors la politique pour se consacrer à l’enseignement et à l’écriture de plusieurs ouvrages.
 |
[16] Le Vénitien Fra Paolo Sarpi (1552-1623) fut membre du Conseil des Dix. Ami de Galilée, de nombreux passages de ses écrits montrent sa sympathie pour la religion réformée, ce qui le rendit suspect au Saint-Siège. Plus grave, il défendit fermement sa patrie dans les démêlés qu’elle avait avec le pape Paul V, lequel dépêcha à deux reprises des sbires pour le faire assassiner en 1607. Il ne fut que blessé.
 |
[17] Charles Nicolas Fabvier (1782-1855) avait servi dans l’artillerie sous l’Empire et avait gagné le grade de colonel et fait baron par Napoléon pendant la campagne de Saxe. Ayant conservé son grade sous la Restauration, il fut poursuivi sur les instances du général Canuel pour une brochure ou celui-ci s’estimait diffamé à propos des troubles survenus à Lyon en 1817. Il fut condamné puis mis en disponibilité. Au mois d’août 1820, il fut soupçonné d'avoir pris part à la conspiration militaire que jugeait alors la Cour des pairs. Relaxé, il fut cité comme témoin. Il refusa de donner un nom qui lui était demandé par le procureur général. La Cour le condamna pour ce refus à 500 francs d'amende. En 1822, il fut accusé d’avoir tenté de favoriser l’évasion des quatre sergents de la Rochelle. Voulant se soustraire aux persécutions du pouvoir, il s’engagea du côté des libéraux espagnols pour combattre le corps expéditionnaire français. L’Espagne revenue dans le système de la Sainte-Alliance, il s’engagea auprès des Grecs qui livraient la guerre d’indépendance. Louis-Philippe le fit pair de France en 1845. Après le coup d’État de Napoléon III, il se retira de la vie publique. Il rendit visite à Courier qui purgeait ses deux mois de prison.
 |
[18] Le vicomte Jean-Jacques de Foucault (1771-1854) était colonel de gendarmerie. A ce titre, le 3 mars 1823, il expulsa de la Chambre le député libéral Manuel.qui s’était vigoureusement opposé à l’expédition d’Espagne. Courier voit en lui un noble indigne de ses ancêtres dont le vicomte se vantait et cite, à son propos, en les adaptant, deux vers de Boileau tirés de sa Satire sur la Noblesse (vers 35 et 36) :
Mais la postérité d’Alphane et de Bayard
Quand ce n’est qu’une rosse est vendue au hasard.
Il n’est pas inutile de savoir qu’Alfane et Bayard sont, non pas des chevaliers mais deux chevaux : Alfane était la jument du roi Gardasse dans le Roland furieux et Bayard, la monture de Renaud de Montauban dans les Quatre fils Aymon.
Victor Hugo se souviendra de cet épisode peu reluisant en écrivant dans les Châtiments, livre IV, poème XI :
Vicomte de Foucault, lorsque vous empoignâtes
L’éloquent Manuel de vos mains auvergnates,
Comme l’océan bout quand tressaille l’Etna,
Le peuple tout entier s’émut et frissonna…
 |
[19] Jeanne Louise Campan (1752-1822) était première femme de chambre de Marie-Antoinette. Elle fonda à Saint-Germain-en-Laye l'« Institution Nationale de Saint-Germain », un pensionnat de jeunes filles où fut élevée Hortense de Beauharnais. Elle y fut remarquée du premier consul, Bonaparte, dont elle avait élevé deux sœurs, Pauline et Caroline. En 1807, Napoléon la mit à la tête de la « Maison impériale d'Écouen », une maison d'éducation de la Légion d'honneur où devaient être élevées les filles des officiers de la Légion d'honneur. Au retour de Louis XVIII, elle fut disgraciée pour avoir été trop proche de Napoléon. Ses Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre, furent publiés par Baudouin frères, en 1822.
 |
[20] Henry Edward O’Meara (1786-1871) médecin irlandais, attaché par le gouvernement anglais à Napoléon détenu à Sainte Hélène.
 |
[21] Françoise de Motteville (1621-1689), au service d’Anne d’Autriche est l’auteur de Mémoires sur Anne d’Autriche et sa cour ; Francis Marie Riaux en a donné une édition annotée en 4 volumes en 1855 avec notice de Sainte Beuve. - Femme de chambre de la marquise de Pompadour, Mme du Hausset (1720-1780) a bien connu les coulisses du pouvoir et les dessous de la cour de Louis XV. Discrète compagne de la favorite, elle a rapporté sur le Versailles des années 1747-1764 et sur son monarque des informations de premières mains. Ces Mémoires dépeignent un monde corrompu, aux mœurs dépravées et constituent les prodromes de la future révolution. Ils sont parus en 1825. Hippolyte Fournier en a publié en 1891 une édition annotée.
 |
[22] Augustin Arguelles (1775-1844) est une noble figure de libéral espagnol. Déporté par Ferdinand VII à Ceuta puis dans l’île déserte de Cabrera, il fut libéré par la révolution de 1820 qui le nomma ministre de l’Intérieur. Ce fut un modéré. Il dut s'exiler lors de la réaction de 1823 et ne rentra dans sa patrie qu'en 1834.
 |
[23] Francisco Espoz y Mina (1784-1836), terrible chef de guerilleros, tua de nombreux soldats de Napoléon. En 1814, il se réfugia en France pour se soustraire à la tyrannie de Ferdinand VII. Rappelé dans sa patrie par la Révolution libérale de 1820, il combattit contre l’armée française venue au secours de Ferdinand et, réfugié dans Barcelone avec seulement 6000 hommes, résista deux mois aux 20 000 des forces du maréchal Moncey avant de capituler le 1er novembre 1823.
 |
[24] Fils et petit-fils de peintres, Horace Vernet (189-1863) se rendit célèbre par ses peintures militaires.
 |
[25] Citation prise chez Boileau, Art poétique, chant III, 53 :
Mais il est des objets que l’Art judicieux
Doit offrir à l’oreille, et reculer des yeux.
 |
[26] Claude-Victor Perrin, dit Victor (1764-1841). Engagé comme tambour en 1781, il devint capitaine en 1792 et, cinq ans après, général de division. A la bataille de Friedland, il remplace Bernadotte blessé et décide de l’issue victorieuse de la bataille. En remerciement, Napoléon le fit maréchal et duc de Bellune le 13 juillet 1807. Il participe à la campagne de Russie. En 1814, l’empereur, mécontent de lui, lui retire son commandement. Aussi Victor rallie-t-il tout de suite la première Restauration. Il suit Louis XVIII à Gand. Le roi de retour à Paris le charge d’examiner la conduite des officiers pendant les Cent Jours et le fait pair de France. Il vote la mort de son ancien collègue le maréchal Ney. En 1821, il fut ministre de la guerre. Il est l’exemple même du parvenu.
 |
[27] Madame est la duchesse de Berry et Mademoiselle, sa fille, née le 21 septembre 1819 et sœur du comte de Chambord.
 |
[28] Antoine Geneviève (sic) Héraclius Agénor duc de Guiche puis duc de Gramont (1789-1855) grandit dans les milieux des émigrés. Il combattit dans les rangs anglais en Espagne. Maréchal de camp en 1814, il accompagna le duc d’Angoulême en Espagne en 1823 et fut promu lieutenant-général à l’issue de la campagne. En 1830, il suivit Charles X en exil.
 |
[29] Cette croyance populaire était d’autant plus répandue que Napoléon était déjà rentré de sa détention dans l’île d’Elbe. On prétendait que l’empereur déchu combattait en Espagne sous le nom de Malemort et allait renter en France à la tête d’un corps de 200 à 300 000 hommes.
 |
[30] Henri Auguste Georges du Vergier, marquis de La Rochejacquelein ((1805-1867) n’avait que 18 ans à l’époque de la guerre d’Espagne où il prit du service comme sous-lieutenant de cavalerie. Par ironie, Courier l’oppose au valeureux Murat.
 |
[31] Courier qui se méfiait de la police désigne probablement sous ces initiales un écrivain ou un de ses amis, adversaire comme lui du régime en place.
 |
[32] Président du collège électoral de Haute-Garonne et député en 1815, fait pair de France le 5 mars 1819, Etienne-François-Xavier-Amable, marquis de Catelan, né vers 1740, se soucia des conséquences de la guerre d’Espagne pour l’agriculture et le commerce français.
 |
[33] Nommé par Napoléon général de division le 20 mars 1813, chef d'état-major du prince d'Eckmühl en 1815 Armand-Charles de Guilleminot (1774-1840) fut nommé par la Restauration directeur général du dépôt de la Guerre. De ce fait, il dressa le plan de la campagne d’Espagne en qualité de chef d’état-major du duc d’Angoulême qu’il accompagna dans son expédition. Contrairement aux assertions de Courier, il ne fut pas disgracié car il bénéficia de la protection du duc d’Angoulême contre les monarchistes ultras qui réclamaient sa perte.
 |
[34] Antoine de Pas, marquis de Feuquières (1648-1711) servit sous les ordres de Turenne et Catinat. Il contribua à la victoire de Neerwinden où il commandait comme lieutenant général. Disgracié quelques années plus tard pour avoir parlé trop librement, il écrivit des Mémoires sur la guerre, dont Voltaire s’inspira pour son Siècle de Louis XIV. Ces Mémoires furent publiés en 1770.
 |
[35] Louis-Aloys, prince de Hoenlohe (1765-1829) servit sous la Révolution dans l’armée des émigrés. Louis XVIII lui accorda la nationalité française en 1823et le nomma lieutenant-général. Charles X le nomma maréchal en 1827 et pair de France, réalisant la prévision de Courier.
 |
[36] Marie-François-Henri de Franquetot, duc de Coigny (1737-1821) servit dans les armées de Louis XV et Louis XVI et, pendant la Révolution, dans l’armée des princes. Louis XVIII le nomma pair, maréchal de France et gouverneur de l'Hôtel des Invalides. – Joseph-Hyacinthe du Houx de Vioménil (1734-1827), autre soldat de l’armée des princes que Louis XVIII éleva à la pairie en 1814. Il suivit le roi dans son exil de Gand et devint maréchal de France en 1816. En 1817, Louis XVIII le fait marquis et, en 1823, officier de la Légion d'honneur.
 |

|













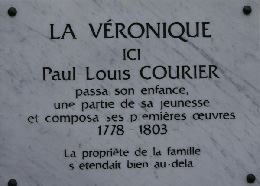

 Introduction au livret de Paul-Louis
Introduction au livret de Paul-Louis


